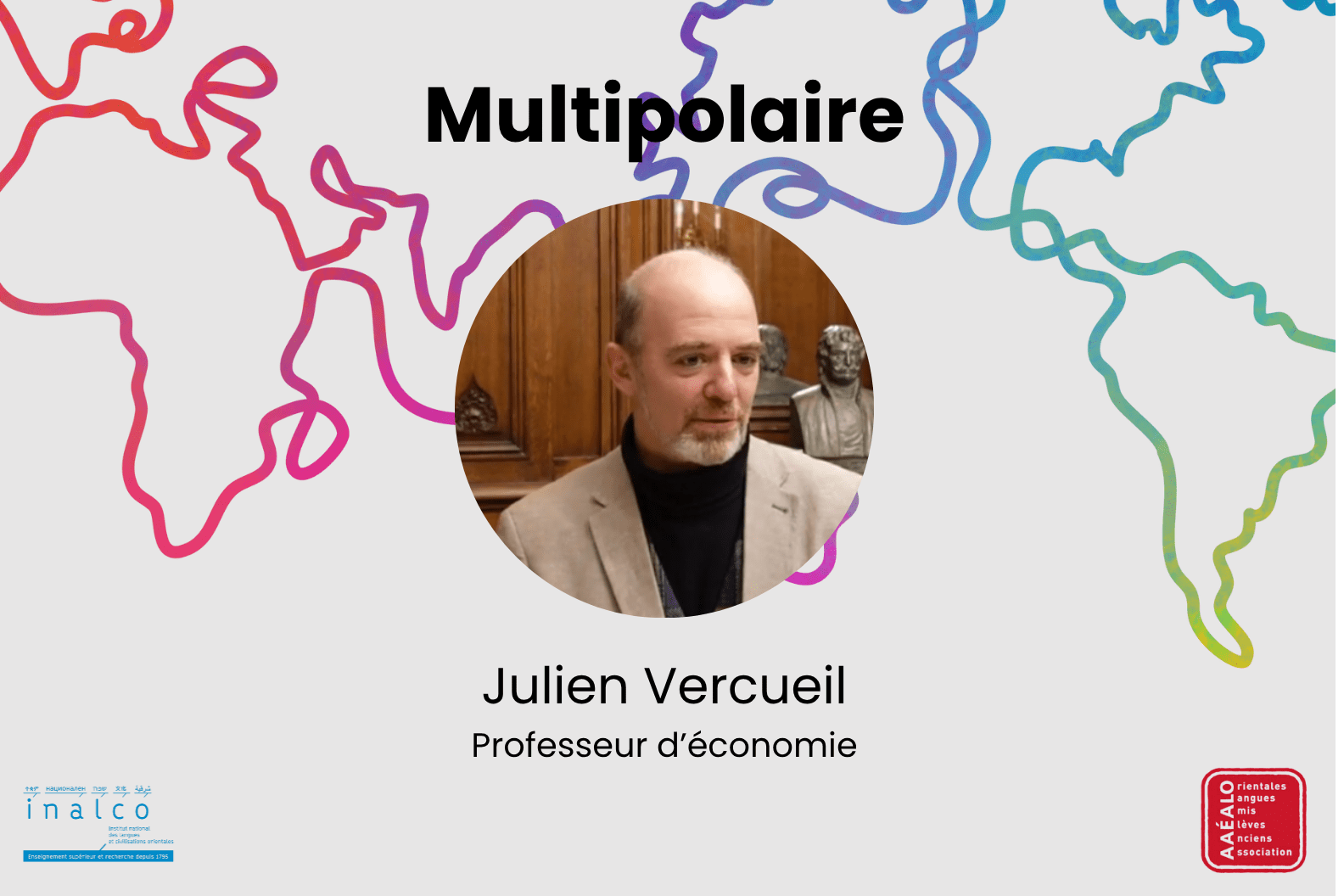Fragmentation mondiale, économie russe et BRICS : entretien avec Julien Verceuil (Multipolaire – AAEALO)
Dans ce deuxième épisode de Multipolaire, le podcast des alumni de l’Inalco, nous recevons Julien Verceuil, professeur d’économie, spécialiste de la Russie, des économies post-soviétiques, et des BRICS, ainsi que vice-président de l’Inalco. À travers son parcours d’enseignant-chercheur et ses travaux sur l’émergence économique, il éclaire les grandes transformations géopolitiques et économiques du monde contemporain : fragmentation des échanges, recomposition des blocs, effets de la guerre en Ukraine sur l’économie russe, et mutation des relations internationales.
Un épisode riche et accessible pour mieux comprendre comment l’économie éclaire la géopolitique, et comment les dynamiques internationales influencent le travail des chercheurs, des institutions et des entreprises.
ÉCOUTER L'ÉPISODE
QUI EST JULIEN VERCEUIL ?
Professeur d’économie à l’Inalco depuis 2011, Julien Verceuil enseigne au Département d’Études Russes et en Commerce International. Vice-président de l’établissement, il est spécialiste de l’économie russe, de la transition post-soviétique, des BRICS et des économies émergentes.
Son expertise porte à la fois sur :
les transformations économiques de la Russie (transition, sanctions, économie de guerre) ;
l’évolution de la coopération au sein des BRICS ;
la fragmentation des échanges commerciaux ;
les enjeux de régulation financière internationale ;
la relation entre géopolitique et décisions économiques.
Julien Verceuil est également engagé dans la gouvernance de l’Inalco et accorde une importance particulière à la rigueur, au partage, à la curiosité et à la transmission — valeurs qu’il explore dans cet épisode.
GRANDES THÉMATIQUES DE L’ÉPISODE
Le métier d’enseignant-chercheur et ses trois piliers : enseigner, rechercher, gouverner
Pourquoi la Russie est une clé de compréhension géopolitique
La fragmentation des échanges mondiaux et la montée des protectionnismes
Les impacts économiques de la guerre en Ukraine et des sanctions
Comment les entreprises sont directement concernées par les tensions géopolitiques
Le rôle de la rigueur scientifique dans l’analyse économique
Ce que l’Inalco apporte aux étudiants et chercheurs
Conseils aux étudiants : engagement, curiosité, ouverture, patience
RECOMMANDATIONS DE LECTURE
📚 Aiyar S., Presbitero A., Ruta M. (Eds.) – Geoeconomic Fragmentation. The Economic Risks from a Fractured World Economy, CEPR Press & IMF, 2023
📚 UNCTAD – Global Trade Update, octobre 2025
📚 IMF – World Economic Outlook, octobre 2025
📚 Julien Verceuil – Économie politique de la Russie 1918–2018, Le Seuil, 2019
📚 Julien Verceuil – Les pays émergents. Brésil, Russie, Inde, Chine… Mutations économiques, crises et nouveaux défis, Bréal, 2015
TRANSCRIPTION COMPLÈTE DE L’ÉPISODE
Dans un monde marqué par la montée des crises et conflits où les rapports de force évoluent sans cesse, la compréhension fine des dynamiques culturelles, linguistiques et géopolitiques est plus essentielle que jamais. Je suis Margot Drancourt de Lastery, ancienne élève de l'Inalco et l'hôte du Podcast Multipolaire, le podcast des anciens de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Nous invitons des anciens élèves pour qu'ils nous éclairent sur les enjeux de l'actualité internationale. Un podcast réalisé en partenariat avec Narastoria.
Bonjour Julien, vous êtes enseignant chercheur à l'Inalco, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes pour nos auditeurs ?
Je suis professeur d'économie à l'Inalco et plus exactement dans 2 départements, un département d'études russes et la filière commerce international. En matière de recherche, je suis spécialisé dans l'économie de la Russie, l'espace post-soviétique, les économies qui ont été en transition, et la notion d'émergence économique, et en particulier les BRICS. Et puis, j'ai aussi une activité administrative, puisque je suis vice-président de l'Inalco, en charge de la valorisation et de la responsabilité environnementale de l'établissement.
Merci pour cette présentation, Julien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vouliez faire à 7 ans?
Bon, il a fallu que je réfléchisse un peu pour vous répondre parce que je ne me souvenais pas trop. Et en fait, j'avais 2 souhaits. Le premier, c'était avec mon frère de travailler dans un camion à pizza et de se déplacer en France, et lui au volant du camion et moi à faire les pizzas ou l'inverse. C'était ça le projet. Et puis le 2e, à peu près au même âge, c'était d'être footballeur professionnel, donc ça c'est plus commun. C'est un peu moins extraordinaire. Et je dois dire que je n'ai réalisé ni l'un ni l'autre.
Est ce que vous pouvez partager avec nous ce qui vous a amené à l'Inalco?
Oui, c'est une histoire qui remonte en fait à la dissolution de l'Union soviétique. Donc 1991-1992. À cette époque-là, j'étais encore étudiant et se posait la question de la recherche. J'étais étudiant en économie. Et j'ai à ce moment-là réalisé que dans le contexte de la dissolution de l'Union soviétique, le fait d'avoir fait du russe au lycée était un atout parce qu'il me permettait d'accéder directement aux sources et que la question des transformations économiques de toute cette région est une question absolument passionnante pour tout économiste. Donc j'ai fait ma thèse sur le sujet de la transition économique de la Russie. Et c'est grâce à cette thèse que bien après une trentaine d'années plus tard, j'ai finalement postulé et obtenu un poste de maître de conférences à l'Inalco en 2011. Je connaissais évidemment l'existence de l'Inalco, mais je ne savais pas qu'il y avait un poste d'économiste de la Russie à l'Inalco et j'étais très heureux et content de pouvoir le l'obtenir.
Julien, en quoi consiste votre métier alors ?
Il y a plusieurs parties dans le métier d'enseignant chercheur. La première partie, celle que je considère comme la plus importante, c'est d'enseigner. On a des étudiants qui ont des âges assez différents. Ils peuvent sortir du baccalauréat et donc découvrir l'université en même temps qu'ils découvrent la matière. On a aussi des étudiants qui peuvent être en thèse avancée, donc on a une très grande variété de niveaux d'étudiants. Il faut s'adapter à chaque cas et à chaque groupe. Et évidemment, on n’enseigne pas la même chose à chaque fois. Par exemple, il peut y avoir des cours d'économie un peu générale, ou alors des cours d'économie très spécialisés sur par exemple la Russie entre 1990 et 1998. Et donc c'est aussi une matière, l'économie, dans laquelle chaque cours doit être réinventé par rapport au cours précédent. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, surtout dans nos régions.La 2e partie de ce métier, c'est de faire de la recherche. Et l'avantage à l'Inalco, c'est qu'on peut mêler les 2, c'est-à-dire nourrir certaines de ces questions de recherche par des échanges qu'on a avec des étudiants ou à l'inverse expliquer à certains de nos étudiants ce qu'on a découvert en recherche. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand on cherche, parfois on trouve. Et y a un certain nombre de résultats qui peuvent être présentés. Et le travail du chercheur, c'est d'être sûr que ces résultats sont rigoureusement étayés, qu’il arrive à des conclusions qui sont robustes. Sur les questions d'économie contemporaine, la robustesse est très relative, il faut la qualifier. On n'est pas toujours sûr de ce qu'on avance. Le pire pour un économiste, c'est de penser que ses prédictions sont des prédictions qui peuvent être prises. Au sérieux sur le long terme. Donc ce qu'il faut, c'est élaborer des scénarios, imaginer le caractère vraisemblable ou plus ou moins de tel ou tel scénario et les proposer à la discussion. Et puis la 3e partie du métier d'Enseignant-Chercheur, pour ceux qui le souhaitent, c'est d'entrer un petit peu dans la mécanique de l'université, c'est-à-dire de prendre des responsabilités de direction, de département, de direction, de centre de recherche. Ou alors de participer à la gouvernance de l'établissement, c'est-à-dire à son pilotage. L'avantage de l'Inalco, encore une fois, c'est que c'est une maison qui n’est pas très grande, dans laquelle quand on essaie de mettre en place une politique, on en voit les effets avant d'être parti. Donc ça c'est pour toutes ces raisons. Le fait d'être à l'Inalco est quelque chose de très plaisant, très valorisant et très intéressant.
Enseignant-chercheur, qu'est-ce que vous cherchez au juste ? Est-ce que vous pourriez partager un ou 2 exemples de recherche que vous faites actuellement ?
Oui, il y a évidemment plusieurs sujets sur lesquels je travaille simultanément. En fait, c'est souvent le cas des anciens chercheurs. Ils n'ont pas un seul sujet sur lequel ils dédient la totalité de leur de leur temps. Premier de ces 2 sujets, c'est la manière dont les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et maintenant d'autres pays qui les ont rejoints) organisent leur coopération économique. Donc la question c'est comment faire pour identifier ce qui change grâce au groupe des BRICS dans leur coopération économique ? Ce sont des pays qui évidemment coopéraient avant que les BRICS existent. Mais la question, c'est ce qui fait que ce groupe, ce collectif, cet ensemble, apporte quelque chose à leur coopération et en particulier comment la coopération qui était bilatérale devient vraiment plurilatérale, c'est à dire devient vraiment quelque chose qui est porté par le groupe en tant que tel et non pas par un binôme à l'intérieur du groupe ? Et pour l'instant, par exemple, on a des thèses qui critiquent les BRICS sur le mode de cette relation bilatérale ou sur le mode d'une asymétrie très forte d'un des partenaires des BRICS par rapport aux autres. Donc il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut faire ce type d'analyse, par exemple le sujet monétaire qui est un sujet tout à fait important aujourd'hui et monétaire et financier. Mais il y en a d'autres. Et le 2e exemple que je pourrais citer, c'est celui de la manière dont les la guerre a impacté l'économie de la Russie, la guerre en Ukraine en particulier, essayer de bien comprendre et faire comprendre les impacts différents et mêlés de du phénomène de la guerre lui-même sur l'économie de la Russie et du phénomène des sanctions. Les le public a tendance à confondre les 2, voire à identifier guerre et sanctions. Or, il est important de bien différencier les effets de chacun des 2, même si c'est extrêmement difficile à faire. Mais au moins tendre vers cet effort-là, ça fait partie de certaines des recherches que je mène aujourd'hui.
Quelles sont les compétences clés pour réussir au métier d'enseignant-chercheur ?
Il faut des compétences et puis c'est parfois aussi un peu de chance. Pour les compétences, le fait de durer en tant qu'enseignant chercheur, c'est lié à mon avis à une forme de patience. Un enseignant chercheur qui est impatient va avoir du mal avec ses étudiants et va avoir du mal avec ses collègues. Donc d'un point de vue tout à fait personnel, pour son propre équilibre, l'enseignant chercheur a intérêt à être patient après. Je crois qu'il y a vraiment une motivation chevillée au corps qui est celle du partage. On doit rechercher l'information, rechercher les conseils qui peuvent être donnés par des pairs quand on est chercheur. Et on doit aussi être prêt à les partager ensuite, à convaincre, à embarquer ses interlocuteurs avec soi, que ses interlocuteurs soient des enseignants chercheurs eux-mêmes dans des colloques. Dans des congrès ou des réunions de recherche, ou qu'ils soient des étudiants. Parce que le but c'est aussi de faire passer des messages et de transmettre des compétences. Donc cette question du partage, elle est extrêmement importante. Et dans tout ça, la 3e compétence qui me semble être utile, c'est celle de la rigueur, c'est-à-dire essayer d'avoir un cap méthodologique que l'on s'applique à soi-même en tant que chercheur et enseignant. Et que l'on essaie d'inculquer, de transmettre, de diffuser auprès de ses étudiants et auprès des jeunes chercheurs. Que l'on forme aussi quand on est enseignant chercheur.
De la patience, il en faut aussi sans doute pour les publications de recherche.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est quelque chose qui est peut être moins connu, mais le rythme de la recherche, qu'elle soit appliquée d'ailleurs aux fondamentales, est un rythme très différent du rythme d'une publication de grand public. Les enseignants chercheurs sont habitués à attendre parfois 6 mois, un an avant d'avoir une réponse de la part de leur éditeur sur le fait que ce qu'ils ont proposé comme article sera accepté ou pas. Et ensuite il peut se passer encore quelques mois avant que l'article ne soit publié. Ce n'est pas toujours le cas. Il existe aussi des cas où on a des publications qui sont rapides, mais on a vu dans le cas du COVID que certaines publications très rapides pouvaient donner lieu à des rétractations après, parce que le travail fondamental de la rigueur dont je parlais tout à l'heure dans l'analyse par les pairs d'un article de recherche n'avait pas été fait ou n'avait pas été fait suffisamment lentement pour être bien fait. Donc cette patience, elle se trouve également dans le processus de publication scientifique et c'est important de le savoir avant de commencer à essayer d'embrasser cette carrière de chercheur.
Julien, est-ce qu'il y a une particularité à enseigner à l’Inalco ?
Il y a des éléments qui sont sans doute communs à beaucoup d'universités, mais il y a aussi des choses que j'ai trouvées à l'Inalco, que je n'avais pas trouvé ailleurs avant. Par exemple, les collègues enseignants chercheurs sont parfois les seuls de France et dans certains cas d'Europe, « exemplaire » si j'ose dire, de leur discipline, ? Certaines langues sont extrêmement rares, rarement enseignées, et donc on trouve des spécialistes à l'Inalco qu’on ne trouve pas ailleurs. Et une autre spécificité, c'est d'avoir un public d'étudiants extrêmement varié, dans ses origines, dans ses origines également historiques, ses parcours de vie, on a des étudiants qui peuvent être d'âge déjà non pas avancé, mais qui sont déjà actifs en proportion plus importante que dans d'autres universités. Et puis on a des étudiants qui ont des origines géographiques, des parcours familiaux issus de l'immigration à une proportion qui est peut-être spécifique aussi parce que on enseigne des langues qui font référence à des parcours de vie de ces personnes-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette proportion d'étudiants qui viennent de pays étrangers augmente avec le niveau par exemple. Les anciens étudiants qui ont un doctorat sont pour moitié des étudiants qui ont la double nationalité ou qui ont une nationalité étrangère, donc ça veut dire que on a une vraie image de ce que l'Inalco peut faire rayonner, de la capacité des universités françaises à attirer des compétences et des talents qui viennent de partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très plaisant dans l'enseignement, parce que ça nourrit aussi les échanges qu'on peut avoir avec les étudiants. Quand on a des étudiants qui sont tous formatés de la même façon, on risque d'avoir des questions de la part des étudiants qui sont à peu près les mêmes. Lorsqu' ils ont cette diversité-là, et bien, on a des échanges qui sont extrêmement variés, avec des expériences partagées par les étudiants qui sont très diverses. Ça, c'est intéressant aussi. Et ça se trouve certainement aussi dans d'autres universités, mais peut-être pas au point auquel je l'ai trouvé à l'Inalco.
Et maintenant, on va passer aux questions géopolitiques. Julien, pour vous, par rapport à votre métier d'enseignant chercheur, quelles sont les questions géopolitiques les plus prégnantes en ce moment ?
Dans le domaine économique, il y a une question qui est tout à fait fondamentale, c'est la question de la fragmentation des blocs d'échanges, la fragmentation commerciale. La montée des barrières tarifaires non tarifaires, la montée de la conflictualité commerciale entre les régions et entre les pays. C'est quelque chose qu'on voit venir depuis plusieurs années, notamment depuis le début des années 2000 qui a vu la crise de l'Organisation mondiale du commerce, le fait qu'elle soit bloquée dans son fonctionnement. Et ça, c'est un problème tout à fait fondamental parce que ça détermine en partie d'autres formes de relations internationales. C'est-à-dire que des sujets commerciaux contaminent d'autres sujets, comme les sujets d'investissement ou les sujets de migration ou d'autres sujets. Ça, c'est un point qui est d'autant plus problématique, qui nous ramène une centaine d'années en arrière, dans les années 20 et les années 30 du XXe siècle où on a connu ces sujets de montée des nationalismes et de montée des protectionnismes en Europe, mais dans le monde entier. En réalité, et associé à cela, il y a la question de l'instabilité financière internationale qui elle aussi est un sujet économique avant tout, mais qui a des implications géopolitiques majeures. Donc pour l'économiste, je dirais que l'un des gros problèmes sur lesquels il doit se pencher, s'il s'intéresse aux questions géopolitiques, c'est la question du devenir de la coopération commerciale et du devenir de la régulation financière par les institutions financières internationales ou par les institutions qui ont pour tâche de réguler le commerce mondial.
Quel est l'impact des changements géopolitiques actuels sur votre métier ?
Ils sont nombreux parce que je m'intéresse à une région qui est secouée par des changements brutaux, fondamentaux et qui ont des conséquences dramatiques. Donc la première des conséquences, la conséquence immédiate que j'ai eue, c'est sur mes relations avec mes collègues russes, puisqu' on s'est trouvé du jour au lendemain, à partir du 24 février 2022, coupés par une sorte de rideau de fer invisible qui s'est abattu entre la Russie et l'Europe occidentale. C'est une question qui est difficile parce qu’on est tiraillé entre le sentiment professionnel de devoir continuer à maintenir des liens forts avec ces interlocuteurs scientifiques d'un côté, et de l'autre côté, un sentiment lui-même ambivalent puisque on ne veut pas mettre en danger ces personnes dans un cadre qui peut devenir totalitaire et qui l'est devenu dans une certaine mesure pour la Russie. Et d'un autre côté, le fait que certains de nos collègues ont pris fait et cause pour la guerre. Donc on a cette double tension qui est particulièrement difficile. Et ensuite il y a des aspects peut-être plus techniques et moins humains, mais qui sont aussi importants, qui est le fait qu’en touchant à l'économie, on touche à des sujets qui peuvent être instrumentalisés politiquement. Donc on touche aussi à la manière dont on construit les chiffres, dont on construit les données, donc on construit l'information économique. Et là, notre devoir de chercheurs, c'est d'être conscient de cela et d'essayer de trouver les stratégies et les méthodes qui permettent de faire face à cette difficulté de la construction des données, de la manipulation des données et de la transformation des données. C'est un travail qui n'est pas très simple mais qui est intéressant intellectuellement. Et enfin, le dernier point, c'est plus sur le travail du de l'enseignant, c'est d'arriver à traiter ces sujets qui sont des sujets importants pour nos enseignements, devant des étudiants qui ont des parcours de vie et des expériences très diverses, en essayant de ne pas les heurter les uns ou les autres. Et en même temps de leur donner un message qui soit le plus juste possible. Et je dirais que dans ce cas-là, la bonne façon de faire, en tout cas celle que j'ai appliquée, c'est d'insister sur les méthodes, d'insister sur le regard critique, le questionnement, la confrontation des sources, la qualification des sources. Et pour terminer, d'éviter de se laisser piéger par la volonté de faire en bon anglais du « wishful thinking », c'est-à-dire de se dire « j'aimerais bien que ce soit comme ça et donc je vais essayer de présenter les choses de la manière qui m'arrangerait a priori ». C'est un biais que tout le monde a, y compris les enseignants chercheurs, et qu'il faut chez les étudiants aussi pointer de façon à ce qu'ils soient eux-mêmes conscients de cela et qu'ils puissent s'en prémunir autant que faire se peut.
Vous parlez de rigueur scientifique en ce qui concerne notamment la qualification des sources. Mais chaque nation, chaque pays peut invoquer le fait qu’une source gouvernementale ou une source médiatique fait foi.
Tout à fait. C'est un problème auquel il faut là aussi faire face soi-même. Et puis sensibiliser ses étudiants. Et en fait la question c'est plutôt : comment les agences qui produisent l'information, par exemple les agences nationales de statistiques, il en existe partout, comment elles font leur travail ? Dans quelles conditions ? Si ces conditions sont techniquement et politiquement de nature à leur garantir une forme d'indépendance et de critique vis-à-vis d'autres institutions, alors on peut considérer que la fiabilité est sinon garantie au moins préservée. Si en revanche on voit qu'il y a une pression politique en amont sur cette agence qui produit le chiffre à ce moment-là, on sait qu’il y a un risque d'instrumentalisation de cette source. Donc il y a la source brute de l'information qui est l'organisme statistique. Il y a ensuite l'agence de presse qui va relayer cette statistique et la donnée. Et puis il y a ensuite toute la circulation de la donnée et de l'information dans les cercles de réflexion, les laboratoires de recherche, les think tanks et autres qui participent ou pas dans tel ou tel pays de la critique de tout cela. Et je pense que c'est en ayant en tête tout cet écosystème qu'il faut pouvoir considérer que certaines sources sont plus fiables que d'autres. L'indépendance politique et la qualité technique de la production de l'information brute sont à la base de ce que on peut avoir comme confiance sur ce qui est produit par ces agences.
Est-ce que les entreprises et les institutions ont besoin d'une compréhension fine des enjeux géopolitiques aujourd'hui. Et si oui, pourquoi ?
Alors je suis convaincu qu'elles ont besoin de cette compréhension fine. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que le sujet économique n'est pas déconnecté du sujet géopolitique, autrement dit une décision à un moment donné qui a un impact géopolitique peut entraîner des conséquences économiques à l'échelle macroéconomique, à l'échelle qui touche toutes les entreprises, même les petites entreprises. Autrement dit, il n'y a pas une déconnexion entre ce que les économistes appellent le microéconomique et le macroéconomique. Donc c'est la première raison. La 2e raison, c'est que les entreprises doivent être conscientes de la réversibilité de certaines des décisions qui sont prises à l'échelle politique et donc éventuellement à l'échelle géopolitique. Ce qui est compliqué pour une entreprise parce que lorsqu'elle investit, elle a un horizon de réalisation de cet investissement et ensuite de rentabilisation éventuelle de cet investissement qui est de plusieurs années. Ça veut dire qu'il faut qu'elle se projette sur des événements qui peuvent survenir à une échelle de temps relativement lointaine. Et ça, il ne faut surtout pas qu'elle pense que c'est donné et que c'est acquis. Ce qui ne veut pas dire que la prévision est quelque chose d'inutile. On en a parlé tout à l'heure quand je parlais de scénario, mais ce qui veut dire qu'il faut toujours être conscient que telle ou telle décision peut être remise en cause dans 2 ou 3 ans. Ça, c'est un point important. Et le dernier point qui revient un peu sur ce que je disais initialement, c'est une parabole. Souvent à mes étudiants, j'indique cet intérêt pour la macroéconomie et donc pour les questions géopolitiques. Par un exemple, si vous êtes sur la plage et que votre activité consiste essentiellement à ramasser des coquillages, c'est très bien si vous devenez un expert dans le ramassage des coquillages. Mais si vous ne voyez pas le tsunami qui vient, il ne vous servira à rien de ramasser des coquillages.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ?
Oui, il existe beaucoup d'exemples qui peuvent illustrer cette idée. Celui auquel je pense immédiatement, c'est celui des conséquences de la guerre en Ukraine sur les entreprises françaises. Certaines entreprises étaient en train de nouer des contrats d'exportation, voire d'importation avec des entreprises homologues en Russie. Et pour cela, il faut réaliser des financements et il faut financer cela par des banques. Ces financements peuvent être des financements de court terme. Lorsque les grandes banques russes ont été déconnectées du système Swift, qui est un système qui permet de sécuriser des échanges interbancaires. Eh bien, les banques françaises ont décidé de cesser de financer ces opérations des entreprises françaises avec la Russie, même si ces entreprises n'étaient pas dans des secteurs sous sanctions. Autrement dit, les sanctions économiques ont eu un impact sur des entreprises qui n'étaient pas dans des secteurs concernés par la guerre en Ukraine et par ces sanctions-là. C'est donc une illustration qu'il faut se préoccuper des sujets géopolitiques lorsqu'on est une entreprise, même une petite entreprise qui n'a qu'une activité modeste dans un domaine tout à fait civil et banal. Avec la Russie, lorsqu'on est à l'international, on est exposé à des risques géopolitiques, que l'on soit une grande ou une petite entreprise.
Le mot de la fin, Julien, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à un ou une étudiante de l'Inalco ?
Alors je commencerai par la féliciter d'avoir choisi l'Inalco pour faire ses études supérieures là. Ensuite, je lui dirais qu’il faut qu'il ou qu'elle continue à s'intéresser aux langues et aux civilisations lointaines, non immédiatement à portée de main, parce que c'est quelque chose qui sur le plan de l'épanouissement personnel et sur le plan du signal qui est envoyé à un employeur potentiel et valorisé, et vraiment valorisé. J'ai vu plusieurs fois des représentants du monde de l'entreprise me dire que les langues orientales qui sont apprises à l'Inalco sont le signe d'une exigence forte qui est faite aux étudiants et que ça montre que ces étudiants travaillent et que c'est quelque chose qui est très valorisé. Ça, c'est sur le plan de l'insertion professionnelle, etc. Et peut-être le dernier conseil que je leur donnerai, c'est de s'engager, de rester fortement engagé dans les sujets sur lesquels ils sont. Parce que l'engagement, c'est aussi le gage de l'excellence. C'est à dire ? C'est parce qu'on est intéressé, parce qu'on est motivé, qu’on devient un bon connaisseur de son sujet et qu'on devient capable d'en faire un métier et d'être professionnel sur ce sujet. Et enfin, peut-être au-delà de ce dernier point, encore un autre point qui est de rester très curieux, très ouvert, parce que c'est aussi une des qualités que j'ai pu noter chez les étudiants de l'Inalco, c'est cette aptitude à s'ouvrir à des nouvelles expériences, à de nouvelles possibilités, que ce soit de stage à l'étranger, de mobilité, de trouver un interlocuteur dans une conférence à l'Inalco et d'aller le voir et de discuter avec lui. Pour ensuite déboucher sur un stage ou sur une insertion professionnelle ou autre. Tout ça, ce sont des opportunités qui existent à l'Inalco qu'il faut saisir et être ouvert. Être prêt à un peu de flexibilité, c'est quelque chose qui est un atout chez un étudiant qui restera un atout dans sa vie professionnelle future.
Julien, des étudiants de l'Inalco ont souhaité vous poser une question, nous les écoutons. Bonjour, je m'appelle Salma Mokfi, je suis étudiante en 3e année de licence à l'Inalco. Et avec mes camarades, on voulait vous demander, quelles perspectives envisagez-vous concernant la soutenabilité de l'économie russe actuellement en mode d'économie de guerre ? Et combien de temps lui donnez-vous à tenir ?
Alors il faut d'abord remarquer que c'est une question que se posent beaucoup de gens en ce moment dans le monde. Parce qu'il y a énormément d'enjeux dans la soutenabilité de l'économie de la Russie puisqu'elle est tournée vers l'effort de guerre. Et c'est d'autant plus important que l'économie de la Russie absorbe dans cet effort de guerre une part croissante de ses ressources. C'est en fait essentiellement l'État, qui, par le biais de la fiscalité, par le biais de la demande qu'il adresse à ces entreprises, entretient ce détournement. Et la 2e chose, c'est que ces dépenses sont des dépenses improductives. Elles ne peuvent pas être recyclées comme des dépenses civiles dans le reste de l'économie et alimenter le développement. Donc la question se pose de savoir comment faire tenir cette économie. La réponse ? Très grossière, mais qui est fondamentalement celle à partir de laquelle il faut partir. C'est celle de la capacité de l'économie de la Russie à collecter de l'extérieur dans le reste du monde ses ressources. Et c'est essentiellement par les exportations d'hydrocarbures et de matières premières en général qu'elle y parvient. On estime aujourd'hui que ses recettes d'exportation n'ont jamais été aussi importantes, même si elles sont secrètes partiellement. Et elles suffisent assez largement à financer aujourd'hui cette distorsion de l'économie de la Russie vers l'effort de guerre. Donc la réponse sur combien de temps cela durera ? Cela durera autant de temps que les prix internationaux du pétrole et la capacité de l'économie de la Russie à recycler cette rente pétrolière dans son effort de guerre durera.
Merci Julien, merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager. À bientôt pour un nouvel épisode de Multipolaire. Pour plus d'infos, allez sur alumni.inalco.fr et adhérez à l'Association des anciens élèves de l'Inalco. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Narastoria.

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés