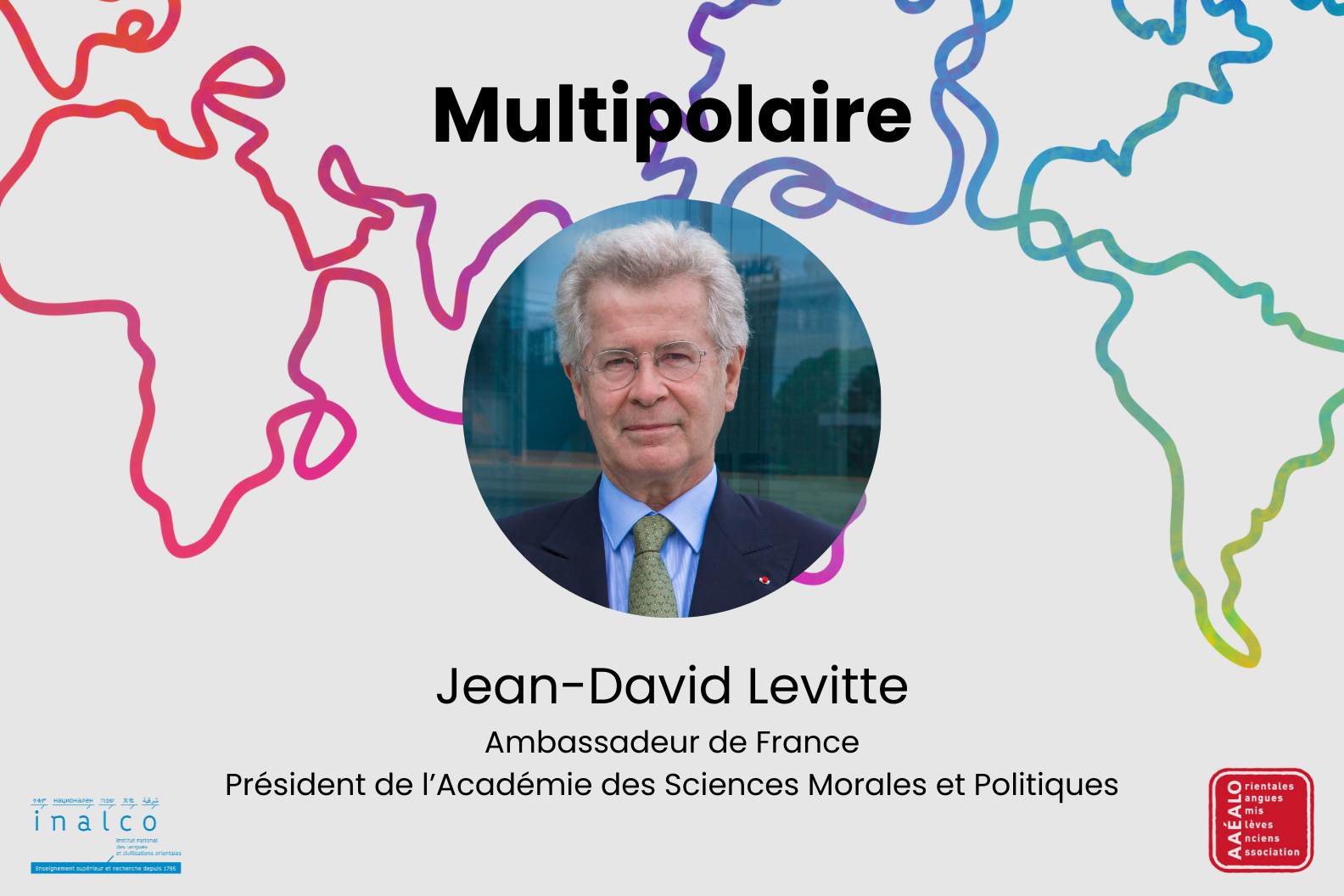Diplomatie, puissances mondiales et avenir de l’Europe : entretien avec Jean-David Levitte (Multipolaire – AAÉALO)
Ancien élève de l’Inalco, où il a étudié le chinois et le malais-indonésien, Jean-David Levitte a construit une carrière au plus haut niveau de la diplomatie française, au croisement du terrain, de la négociation et de la décision stratégique. Représentant permanent de la France auprès des Nations unies à New York (2000–2002), puis ambassadeur de France aux États-Unis (2002–2007), il a été au cœur des grandes crises internationales contemporaines. Dans cet épisode de Multipolaire, il propose une lecture de long terme des rapports de force internationaux et revient sur la place que peuvent y tenir les langues, les cultures et l’expérience du terrain.
ÉCOUTER L'ÉPISODE
Note éditoriale — Cet entretien a été enregistré le 25 novembre 2025 et publié le 24 janvier 2026. Certaines analyses doivent être replacées dans le contexte international de l’époque de l’enregistrement.
QUI EST JEAN-DAVID LEVITTE ?
Diplomate de carrière, Jean-David Levitte a exercé des responsabilités majeures au service de la politique étrangère française. Il a été Représentant permanent de la France auprès des Nations unies à New York (2000–2002), puis ambassadeur de France aux États-Unis (2002–2007). Il a également été conseiller diplomatique et Sherpa de deux présidents de la République.
Il est aujourd’hui président de l’Académie des sciences morales et politiques.
GRANDES THÉMATIQUES DE L’ÉPISODE
Le métier de diplomate : apprendre par l’expérience, écouter avant de parler
Langues, civilisations et trajectoires : ce que l’Inalco apporte à la compréhension du monde
Le 11 septembre 2001 vu depuis le Conseil de sécurité : coalition internationale, évolution du droit international
États-Unis / Chine : évolution du rapport de puissance depuis les années 1970
Taïwan et les scénarios de crise : stratégies, dissuasion, incertitudes
L’Union européenne entre blocs : force économique, bureaucratie, marges de manœuvre
Alliances, valeurs et multilatéralisme : la place de l’Europe face aux logiques impériales
RECOMMANDATIONS DE LECTURE
📚 Jean-David Levitte – « Après cinq siècles de domination occidentale, quel avenir pour le monde ? »
→ Communication à l’Académie des sciences morales et politiques (5 janvier 2026)
TRANSCRIPTION COMPLÈTE DE L’ÉPISODE
Dans un monde marqué par la montée des crises et conflits, où les rapports de force évoluent sans cesse, la compréhension fine des dynamiques culturelles, linguistiques et géopolitiques est plus essentielle que jamais.
Je suis Margot Drancourt - de Lasteyrie, ancienne élève de l’Inalco et l’hôte du podcast Multipolaire, le podcast des anciens de l’Institut national des langues et civilisations orientales.
Nous invitons des anciens élèves pour qu’ils nous éclairent sur les enjeux de l’actualité internationale.
Un podcast réalisé en partenariat avec Narastoria.
Nous avons aujourd’hui l’honneur et le plaisir de recevoir Jean-David Levitte, ambassadeur de France.
Monsieur l’Ambassadeur, merci d’être parmi nous aujourd’hui.
Vous avez eu une carrière de diplomate absolument remarquable, en poste au Quai d’Orsay, en Chine, aux États-Unis et aux Nations Unies.
Vous avez également été conseiller diplomatique et Sherpa de deux présidents de la République.
Vous êtes membre de l’Académie des sciences morales et politiques, dont vous prenez bientôt la présidence.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Ce que je voudrais rajouter, c’est la chance que j’ai eue de servir la France dans toutes ses fonctions absolument formidables.
Une vocation ne naît pas parce que vous êtes né ici ou parce qu’elle vient progressivement.
Elle se révèle à vous.
J’ai eu le sentiment que la chance m’a servi au-delà de tout ce que je pouvais espérer.
Quand je suis rentré au Quai d’Orsay, j’avais l’ambition de servir, de nouer le dialogue, de renforcer le dialogue entre la France, l’Europe et la Chine, l’Asie.
Et puis, progressivement, le spectre s’est élargi.
Les responsabilités se sont accentuées.
Et j’ai été très gâté par la carrière que vous venez d’évoquer en quelques mots.
Et qu’est-ce que vous vouliez faire à 7 ans ?
Rien.
Non… votre question suppose que dès l’âge de 7 ans, on ait une vision quelconque.
À 7 ans, j’habitais à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, fils d’un père ukrainien d’origine russe et d’une mère née au Mozambique, d’origine sud-africaine.
Ils s’étaient connus pendant la Seconde Guerre mondiale à Moissac et s’y étaient installés.
Honnêtement, vu de Moissac, je n’avais aucune vision de mon avenir, ni même aucune connaissance de la vie internationale.
J’étais un Moissagais.
Dans votre parcours, vous avez étudié le droit à Sciences Po et également à l’Inalco. Pourquoi vous y êtes-vous inscrit ?
Après le baccalauréat, j’ai commencé une licence de droit et Sciences Po, comme beaucoup de jeunes.
C’est à partir de ce moment-là que je me suis demandé ce que je souhaitais faire.
J’avais eu un professeur de géographie au lycée Pasteur à Neuilly, absolument formidable, passionnant, qui nous avait tous marqués par sa description des différentes civilisations du monde.
Notamment les civilisations d’Asie, et en particulier la civilisation chinoise.
C’est comme cela que j’ai commencé à découvrir le monde.
Il nous avait raconté quelque chose de très méconnu : on aurait pu tous parler chinois si, sous la dynastie des Ming, l’amiral Zheng He avait réussi à aller plus loin que son parcours.
Je ne vais pas rentrer dans l’histoire.
Mais quelques décennies avant nos propres découvertes, il existait une énorme flotte chinoise, avec 30 000 hommes et des dizaines d’énormes vaisseaux. Ils partaient non pas à la conquête, mais pour faire du commerce, le long des côtes du Vietnam, de l’Inde, de la mer Rouge, de l’Afrique jusqu’au Cap. Il y a eu sept expéditions. Et l’amiral Zheng He est mort pendant la septième. Les bureaucrates de la cour de l’empereur ont alors dit : « Tout cela ne sert à rien. On nous ramène des girafes et de l’ivoire, certes, mais nous n’en avons pas besoin. » La flotte a été détruite.
Quelques décennies plus tard, Christophe Colomb partait, lui, pour une découverte — il le pensait, il l’espérait — de l’Asie. Il a découvert l’Amérique. Puis Magellan, à sa suite, a réussi le premier tour du monde. Tout cela n’est pas, à la base, une histoire de conquêtes impériales, mais une histoire de commerce.
Comme je l’ai dit, l’amiral Zheng He et son énorme flotte partaient faire du commerce. Ils vendaient des porcelaines et ramenaient de l’ivoire, et tout ce qu’on pouvait trouver au passage des nombreuses côtes qu’ils ont parcourues. Les Portugais et les Espagnols se sont lancés dans ces aventures à cause du prix du poivre. Pourquoi ? Vous allez couper tout ça, mais c’est quand même très intéressant : à quoi tiennent les choses ? Pourquoi le poivre était-il si cher ?
Parce qu’il était produit dans les îles d’Indonésie. Il fallait donc le transporter :
d’abord dans des bateaux jusqu’à l’Inde,
puis dans des caravanes à travers le sous-continent indien,
puis de nouveau dans des bateaux pour la mer Rouge,
puis de nouveau dans des caravanes en Afrique du Nord (Égypte, etc.),
puis enfin un dernier trajet en bateau.
À chaque étape, il y avait d’énormes droits de douane à payer. Le poivre était donc hors de prix.
L’idée des Portugais et des Espagnols était d’essayer de trouver un chemin plus court, et surtout sans tous ces droits de douane qui s’accumulaient de passage en passage. D’où, d’abord, la descente le long des côtes africaines. Ils ont réussi à rejoindre les îles d’Indonésie à partir du Cap de l’Afrique. Ensuite, puisqu’ils avaient compris que la Terre était ronde,
ils ont cherché à en faire le tour pour voir s’il existait un raccourci. C’est l’aventure de Christophe Colomb et de Magellan.
À partir de là, l’Occident s’est imposé à la tête du monde. C’est une histoire complètement incroyable de penser que ce petit cap de l’Asie qu’est l’Europe a bâti :
dans les deux Amériques, l’empire brésilien (portugais) et l’empire hispanique,
puis, en Amérique du Nord, plutôt les Anglais que les Français.
Ensuite :
conquête de l’Afrique,
conquête de l’Inde par le Royaume-Uni,
conquête de l’Indonésie par les Pays-Bas,
conquête de l’Indochine par la France.
Bref, le monde était devenu européen. Et tout ça… à cause du prix du poivre.
À quoi tiennent les choses ?
Voilà. C’est l’histoire. C’est le début de ma vocation. Quand vous avez un professeur d’histoire-géographie qui vous raconte cela, vous vous dites : « Mais le monde, ce n’est pas du tout ce qu’on nous raconte. Il faut aller creuser, découvrir. »
Voilà.
À l’Inalco, pourquoi avez-vous choisi d’étudier le chinois et le malais indonésien ?
Le chinois, parce que c’est l’une des deux ou trois grandes civilisations de l’Orient. Cela allait de soi. Nous étions formés, dans nos lycées, à l’étude de la civilisation occidentale.
Si l’on voulait porter un autre regard, c’était naturellement vers la Chine qu’il fallait se tourner. C’est à ce moment-là que j’ai découvert l’existence du concours de secrétaire d’Orient.
En parallèle de ma licence de droit et de mon diplôme de Sciences Po, j’ai préparé le concours d’Orient à travers un diplôme de chinois et un diplôme d’indonésien (malais indonésien).
Et qu’est-ce que vous avez trouvé à l’INALCO ? Un souvenir particulier ? Un professeur marquant ?
Oui.
Un professeur marquant : Jacques Pimpaneau.
Je crois que, pour tous ceux qui ont eu la chance d’être ses élèves, le personnage de Jacques Pimpaneau, son rayonnement personnel, sa culture et sa passion pour l’enseignement laissent un souvenir impérissable.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le métier de diplomate et quelles sont les compétences clés pour y réussir ?
D’abord, le métier de diplomate ne s’apprend pas par des cours. Il s’apprend par l’expérience. Vous commencez en bas de l’échelle diplomatique : en écoutant, en regardant, en apprenant de votre ambassadeur, puis de vos ambassadeurs successifs, de poste en poste.
Il existe des écoles diplomatiques, mais honnêtement, c’est par le vécu aux côtés d’ambassadeurs que l’on apprend le métier de diplomate.
La première leçon que vous apprenez, c’est que ce métier consiste d’abord à savoir écouter. Écouter et comprendre ce qu’attend de vous votre interlocuteur. C’est fondamental. Ce n’est que lorsque vous avez bien compris ce que l’interlocuteur attend de vous que vous pouvez préparer votre réponse.
C’est une leçon qu’on n’apprend ni au lycée ni à Sciences Po, mais en pratiquant le métier de diplomate. On pourrait en parler très longtemps, mais c’est un métier qui s’apprend au fil des années, je dirais même des décennies.
C’est pour cela que c’est très important d’avoir la chance de commencer dans une ambassade, en bas de l’échelle. Regarder comment fonctionne votre ambassadeur. Apprendre de lui le métier sur le terrain. Cela ne s’apprend pas dans les livres : cela s’apprend sur le terrain. Et évidemment, le métier ne s’exerce pas exactement de la même façon quand vous êtes à Pékin, au Caire ou à Dakar.
Chaque pays a sa culture, sa civilisation, ses traditions, son mode de gouvernement. Vous devez vous adapter à toutes ces nuances, à toutes ces différences, de pays en pays.
Donc, un diplômé de l’INALCO qui n’a pas fait l’ENA ou Sciences Po peut devenir ambassadeur ?
Bien sûr. Ce qui est important avant de devenir ambassadeur, c’est d’avoir l’expérience suffisante pour réussir dans le métier d’ambassadeur.
Premièrement : écouter avant de prendre la parole. Regarder son ambassadeur travailler.
Apprendre de lui.
Quand vous avez en face de vous un interlocuteur dans une négociation, vous avez la tentation — surtout quand vous êtes français, avec des instructions qui demandent d’obtenir des choses très ambitieuses — de prendre la parole en premier.
Non. Il faut attendre d’avoir bien compris ce que votre interlocuteur vous dit, ce qu’il attend de vous. À ce moment-là, vous adaptez votre langage, vos messages, en fonction de vos instructions et de ce qu’attend votre interlocuteur.
On vous a surnommé “Diplomator”.
Ah.
Que vaut ce surnom ?
Deux choses.
Lorsque j’étais ambassadeur auprès des Nations unies à Pékin, j’ai vécu comme président du Conseil de sécurité le 11 septembre 2001. La tragédie des tours jumelles détruites par les terroristes. Chacun a en mémoire ce qu’il faisait ce jour-là. Ce jour-là, je présidais le Conseil de sécurité pendant tout le mois de septembre 2001. Depuis les fenêtres de mon bureau, j’ai vu les avions s’écraser dans les deux tours. Les tours se sont effondrées. Et on n’avait plus de téléphone, parce que le central de Verizon était dans l’une des deux tours. Plus de téléphone.
Mais la responsabilité était immense. Les États-Unis allaient naturellement prendre une initiative militaire à la suite de cette tragédie sans précédent. Il fallait remonter à Pearl Harbor pour trouver une agression contre le territoire des États-Unis. Mais Pearl Harbor, c’était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et au milieu du Pacifique. Là, on était dans une période de paix. Le symbole de New York, les deux tours jumelles, dans la ville qui symbolise les États-Unis, a été détruit. Les États-Unis allaient donc réagir militairement, et fortement.
Mais il y avait deux façons de réagir :
seuls,
ou avec une coalition globale.
Or, Jesse Helms, qui présidait la commission des affaires étrangères du Sénat, détestait les Nations unies. Les Américains ne payaient plus leurs cotisations. Ils n’avaient plus d’ambassadeur aux Nations unies. Le risque, c’était une cassure. Les États-Unis se faisant justice, sans soutien, sans coalition globale.
N’ayant pas d’instruction, on a eu le culot — avec mes collaborateurs — de prendre une initiative qui a changé le droit international. À partir de ce jour, le 12 septembre, le lendemain de l’attaque, toute attaque d’un groupe terroriste international contre un État membre des Nations unies ouvre le droit, sous le contrôle du Conseil de sécurité, à la légitime défense individuelle ou collective.
Ça a marché.
Après l’adoption de cette résolution, il a fallu une heure seulement pour que les quinze membres du Conseil de sécurité — les cinq permanents — adoptent cette résolution. Sergueï Lavrov était l’ambassadeur de Russie. Les États-Unis ont décidé de payer leurs arriérés de paiement aux Nations unies. Et d’envoyer leur ambassadeur enfin à New York. À partir de là, on a bâti une coalition globale de lutte contre le terrorisme international.
Donc, c’est peut-être l’une des deux raisons de mon surnom. Évidemment, c’était gonflé d’avoir pris cette initiative sans instruction du Quai d’Orsay et de l’Élysée. Le directeur des affaires juridiques, quand le téléphone a été rétabli, le 12 septembre, m’a appelé en disant :
« Mais qu’est-ce que vous avez fait ? Vous avez pris une initiative. Vous avez changé le droit international. Qui vous a donné la permission ? »
Je commençais à transpirer.
Lorsque Jacques Chirac m’a appelé, il m’a dit qu’il voulait être le premier chef d’État à venir. On était d’accord. Deux ans plus tard, j’ai été nommé ambassadeur aux États-Unis. Le président Bush m’a dit : « Merci pour le 11 septembre. Maintenant, on va partir en guerre en Irak ensemble. » Je lui ai dit : « Non, pas du tout. »
Monsieur le Président, on vient d’adopter une résolution sur l’Irak qui renvoie les inspecteurs. Ce n’est que s’il y a violation de la résolution et rapport des inspecteurs — dont la moitié sont américains — au Conseil de sécurité, que le Conseil de sécurité décidera. Il m’a dit : « Non, pas du tout. On a la volonté d’attaquer l’Irak de Saddam Hussein. » J’ai pris ça en note. Et j’ai appelé Jacques Chirac en lui disant : « Monsieur le Président, on a un problème. »
J’ai vécu ce problème pendant cinq ans. C’est-à-dire : la guerre en Irak et le French bashing, comme on disait. Parce que le gouvernement américain n’arrivait pas à admettre que la France ne soit pas aux côtés des États-Unis dans cette malheureuse guerre en Irak. J’ai passé mon temps à expliquer à la télévision et à la radio, à travers les États-Unis, qu’on n’était pas d’accord, mais qu’on restait des amis et des alliés des Américains.
Ça a été cinq années d’épreuve diplomatique.
Une belle expérience.
Vous avez été ambassadeur de France aux États-Unis. Vous avez été en poste en Chine.
Comment décririez-vous l’évolution du rapport de puissance entre les États-Unis et la Chine depuis vos premières années à Pékin jusqu’à aujourd’hui ?
Le monde a complètement changé.
Lorsque j’étais en poste à Pékin, donc en 1972, 1973, 1974, c’était une Chine qui sortait du Grand Bond en avant, qui sortait à peine de la Révolution culturelle. Donc une Chine affamée, avec des dizaines de millions de morts lors de l’échec du Grand Bond en avant. Une Chine sous le règne, en fin de parcours, d’un Mao qui dominait complètement, mais qui avait à ses côtés un pays affaibli, appauvri, affamé. Et qui avait décidé de rompre avec l’URSS.
Il y avait des troupes massivement alignées le long de la frontière, la rivière Oussouri. Des troupes soviétiques qui menaçaient la Chine. Et mes voisins, dans la rue à Pékin, creusaient des abris pour se protéger des bombardements possibles de la Russie. Mao avait demandé la restitution des territoires volés par l’Empire russe à la Chine par les traités inégaux de 1860.
À ce moment-là, Mao a décidé de basculer complètement. L’alliance entre l’URSS et la Chine était non seulement rompue, mais devenue une hostilité sans limite. Mao s’est tourné vers les États-Unis. Kissinger a eu ce coup de génie de venir à Pékin proposer un changement stratégique sans précédent. Le président Nixon est venu à Pékin sceller cette entente, en tout cas ce partenariat entre les États-Unis et la Chine.
Donc j’ai vécu cet épisode qui est fondateur pour le monde d’hier.
Mais, comme je l’ai dit, Mao n’était pas en état de faire des réformes économiques et sociales. Il a fallu attendre quelques années de plus, 1979, pour que Deng Xiaoping, que Mao avait mis dans les poubelles de l’histoire, ressorte, émerge au sommet de la hiérarchie du pouvoir en Chine et lance ses réformes progressives, pragmatiques.
J’avais rejoint l’Élysée à l’époque. J’avais suggéré au président Giscard d’Estaing d’inviter celui qui n’était pas encore le président de la Chine, mais qui était déjà l’homme dont tout dépendait. Pendant les cinq jours où il est resté en France, il nous a expliqué sa démarche : Une réforme dans une province, elle marche. On l’étend à une deuxième province, etc.
Un proverbe est resté dans ma mémoire : « Quand on veut attraper dix mouches avec dix doigts, on perd tout. »
Et ça résumait bien la différence entre Mao et Deng Xiaoping.
Ça a été une période absolument passionnante. C’est le début de l’émergence de la Chine, qui est aujourd’hui la grande rivale des États-Unis. Les deux sont pratiquement à égalité de puissance, dans une rivalité sans limites.
Tout y passe.
Alors, qu’est-ce qui va se passer ?
Beaucoup va se jouer sur Taïwan. L’actuel président Xi Jinping souhaite le retour de Taïwan et rester dans l’histoire comme celui qui a permis au monde chinois de restaurer son unité. Personnellement, je pense, comme Sun Tzu, que la meilleure victoire est celle qu’on obtient sans livrer bataille. J’espère que ce sera cela la recette du président. Mais Xi Jinping peut avoir une volonté plus ambitieuse ou plus brutale.
Et, à ce moment-là, la grande question, c’est : que feront les États-Unis ?
Pour le reste, la Chine a eu cette croissance économique extraordinaire, mais elle a deux handicaps.
Le premier, c’est la démographie. La Chine, c’est un milliard 400 millions aujourd’hui. Ce sera 800 millions de Chinois à la fin du siècle.
La deuxième difficulté de la Chine, c’est qu’elle n’a pas d’alliés. Elle a des obligés, mais elle n’a pas d’alliés.
L’atout des États-Unis, c’est que c’est le laboratoire où s’invente le monde de demain. Un pays qui attire — ou qui attirait jusqu’à Trump — les élites du monde entier, qui inventent le monde de demain en Californie. Et les États-Unis ont un réseau d’alliances qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire de l’humanité.
Malheureusement pour les États-Unis, Trump ignore ces deux atouts. Il ferme les frontières. Il dissuade ou décourage ceux qui pourraient inventer le monde de demain en Californie. Et il se met à dos ses alliés pour des raisons difficilement compréhensibles. Dans ce match incertain, il y a beaucoup de points d’interrogation.
Le jeu est complètement ouvert.
Et la question qui se pose à nous, Européens, c’est : qu’est-ce qu’on fait ? Surtout avec la guerre en Ukraine d’un côté, et les initiatives de Trump de l’autre. La réponse est évidente.
Il est plus important que jamais qu’on rassemble nos atouts au sein de l’Union européenne. Et c’est exactement ce que nos dirigeants essayent de faire : d’abord face à la guerre d’agression en Ukraine, puis face aux initiatives incongrues du président Trump.
Pour poursuivre un peu, parce que vous avez précédé certaines de mes questions : comment l’Europe peut exister entre ces deux blocs que sont la Chine et les États-Unis ?
Écoutez, je vais vous raconter un épisode de mon séjour d’ambassadeur à Washington qui va vous expliquer pourquoi je suis optimiste. Je m’entendais très bien avec Alan Greenspan, qui était le gouverneur de la Banque centrale des États-Unis.
Lors d’un déjeuner en tête à tête, je lui ai dit : « Mais comment est-ce que vous avez pu laisser les Européens créer l’euro qui peut devenir un rival du dollar ? »
Il m’a répondu avec beaucoup de candeur : « Nous ne pensions pas que vous alliez réussir. »
Je crois que ça résume bien ce qu’est l’Union européenne. C’est-à-dire que depuis les années 50, les pères fondateurs ont un projet extraordinaire, bâti sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, de la haine entre les Allemands, les Français, etc. Rassembler nos forces pour faire émerger, avec Jean Monnet et les autres, l’Union européenne.
On a réussi au-delà de tout ce qu’on pouvait espérer.
Mais on a tellement bien réussi qu’on est devenu une bureaucratie sans limite. Parce que si vous voulez rassembler les marchés de l’Union européenne et créer un marché commun, vous devez avoir des règles communes. Il n’y a pas de marché commun sans règles. Mais alors, la bureaucratie de Bruxelles est une bureaucratie sans limite.
On se dote de règles qui sont devenues des handicaps. Et donc, on a deux rapports qui nous disent : voilà comment il faut sortir de ce bourbier, de l’excès de règles. C’est le rapport de Mario Draghi, le rapport d’Enrico Letta. Si on arrive à les mettre en œuvre, je crois qu’on a vraiment une chance d’émerger comme l’alternative aux deux empires que je vous décrivais : l’empire américain, si je puis dire, avec le président actuel, et l’empire chinois.
Il y a deux visions impériales.
Et puis, au milieu, il y a l’Union européenne, qui propose une vision alternative. Nous ne bâtissons pas en Europe un empire. Nous bâtissons une famille où nous vivons ensemble pour nous bâtir un avenir commun, avec des règles — pas trop de règles. Il faut déréguler.
Mais nous avons la capacité, je crois, et il faut, au-delà de cet avenir commun pour les Européens, avoir l’ambition de bâtir des alliances avec tous ceux qui partagent notre vision des choses.
Une vision qui n’est pas celle de Trump, ni celle de Poutine, ni celle de Xi Jinping.
Des alliés, on en a tout naturellement : Le Canada, le Japon, la Corée, l’Australie, mais aussi le Brésil. Et puis, on a une capacité à aider. Il faut savoir que l’Union européenne représente, avant les décisions de Trump, 43 % de l’aide mondiale au développement. Avec la décision de Trump de supprimer l’USAID, on doit être à plus de la moitié à nous tout seuls.
Donc, cela nous donne un levier.
Mais personne ne le sait. Et donc, il faut qu’on revoie un peu nos règles de fonctionnement. Non pas pour bâtir un impérialisme européen, mais pour proposer à nos partenaires un avenir commun basé sur nos valeurs.
Et en termes de négociation, est-ce que vous pensez qu’avec certains pays européens, il peut y avoir un effet de levier suffisant pour faire le poids face aux États-Unis ou à la Chine ?
Oui et non.
Oui, sur le papier, puisque si vous regardez le poids économique de l’Union européenne, on est le troisième ensemble, en quelque sorte, derrière les États-Unis et la Chine, qui sont presque à égalité.
On est derrière, mais pas très loin.
Et surtout, si on met en œuvre les rapports Draghi et Enrico Letta, on a la capacité de rattraper le retard qu’on a pris, pour raison d’excès de bureaucratie.
Et notre vision de ce que doit être l’ordre international, basée sur ce que nous bâtissons au niveau européen, mais étendue à l’échelle du monde entier, doit avoir une force de séduction.
Elle est grandie par le comportement de la Chine d’un côté et des États-Unis de Trump de l’autre. Donc, on peut, si on est capable de remettre l’Union européenne sur les rails d’un développement plus rapide, avec plus de souplesse…
…et si on est capable d’avoir une vision de ce que doit être notre rôle dans le monde.
Et là, ça dépend beaucoup des principaux pays : la France, l’Allemagne.
J’ai presque la tentation de mettre dans l’ensemble le Royaume-Uni, parce qu’en politique étrangère, les Anglais font partie de la famille européenne.
Nous pouvons bâtir des alliances qui peuvent séduire.
Et prendre des initiatives pour aller au secours ou apporter des contributions positives, que ce soit en Afrique, au Proche-Orient ou au-delà.
Et est-ce que la diplomatie française peut encore peser dans un monde structuré par ces rivalités ? Et si oui, sur quel levier ?
La diplomatie française toute seule, non.
La diplomatie française avec ses partenaires européens, oui.
Et cette réponse tient simplement au constat que le monde d’aujourd’hui a trois visions impériales, fondées sur des valeurs qui ne sont pas celles de l’Europe.
La vision impériale de la Russie, de Poutine, avec la guerre d’agression, pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Ukraine.
Puis la vision de Xi Jinping, Tianxia, « sous le ciel ». Il y a l’empereur, et le rôle des barbares que nous sommes est d’aller à la cour de l’empereur, faire kowtow, et repartir illuminés par la sagesse chinoise.
C’est comme cela, en tout cas, qu’à Pékin on voit le rapport entre la Chine de l’empire retrouvé et les nations qui ont vocation à contribuer au rayonnement de la Chine en absorbant ses recettes et ses produits.
Et puis il y a un troisième empire : celui de Trump. On a la tentation de sourire quand Trump dit : « Je veux que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, que le Groenland fasse partie des États-Unis, que le canal de Panama revienne sous notre contrôle.
Mais je crois qu’on doit considérer avec sérieux ses ambitions.
Je ne pense pas qu’il ait une ambition impériale, mais il veut imposer la domination américaine sans respect aucun pour les règles du jeu bâties par l’Europe depuis le traité de Westphalie, et qui se sont progressivement transformées en Charte des Nations unies et en règles du jeu internationales. Il les ignore complètement. Il négocie des deals avec un rapport de force : celui des États-Unis face aux autres puissances. Et comme il considère — non sans raison — que les États-Unis sont la puissance numéro un, peut-être ex æquo avec la Chine, il veut imposer sa vision, ses deals.
Naturellement, cela n’est pas acceptable dans un rapport d’États conforme au droit international.
Des étudiants de l’INALCO ont souhaité vous poser une question. Nous les écoutons.
Alors, bonjour. Je m’appelle Nathan Rurcat. Je suis en triple cursus ici à l’Inalco : en première année de doctorat de sciences politiques, en troisième année d’ukrainien et en première année de turc.
Ma question, c’était de savoir pourquoi les BRICS+ qui mettent en avant le besoin d’une refonte du système international n’ont pas encore utilisé l’article 109 de la Charte des Nations unies, qui permet de le faire justement.
Alors d’abord, il faut que vous sachiez que la France est favorable à une réforme de la Charte des Nations unies, et notamment de la composition du Conseil de sécurité. Parce que lorsque la Charte des Nations unies a été adoptée, le nombre d’États indépendants était beaucoup plus faible.
Puis les États, les anciennes colonies, sont devenus indépendants : l’empire des Indes, l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh.
Mais surtout, les dizaines de pays africains devenus indépendants ont rejoint.
Donc, il faut une réforme des Nations unies. La France la demande avec le Royaume-Uni. Notamment un deuxième élargissement du Conseil de sécurité pour faire rentrer davantage de pays africains.
On doit s’occuper davantage de l’Afrique, que ce soit aux Nations unies ou ailleurs.
Il y a aussi des États qui souhaitent devenir membres permanents, ce qui est assez légitime compte tenu de leur poids. Si vous regardez l’Inde, par exemple : comment penser que l’État le plus peuplé du monde ne soit pas membre permanent du Conseil de sécurité ?
Le Japon, compte tenu du poids de son économie, mérite d’être membre permanent du Conseil de sécurité.
La France considère que c’est justifié. Elle soutient également la candidature de l’Allemagne, compte tenu de son poids en Europe et dans l’économie mondiale.
Et puis enfin, il faut un État latino-américain. Nous pensons que le Brésil a vocation à être membre permanent du Conseil de sécurité.
Cette réforme nécessaire n’est pas soutenue et est bloquée depuis des années et des années.
Pourquoi ?
Parce que ceux qui estiment devenir victimes de cet élargissement s’y opposent.
Vous prenez le Brésil : on parle portugais. Tous les autres pays d’Amérique latine parlent espagnol, et ils disent : « Pourquoi ce serait un pays parlant le portugais, et pas le Mexique ? »
Si vous regardez la candidature du Japon, le soutien de la Chine n’est pas évident — c’est un euphémisme diplomatique.
Si vous regardez l’Inde, demandez au Pakistan ce qu’il en pense.
Donc vous avez des coalitions qui se forment contre.
Et le rapport de force n’a pas encore assez évolué pour que l’élargissement du Conseil de sécurité, qui nous paraît légitime, que la France réclame depuis des années, puisse être adopté par la majorité nécessaire à l’Assemblée générale.
Alors ça, c’est le monde des Nations unies.
Au-delà, vous savez qu’on a un certain nombre de cercles diplomatiques qui se retrouvent pour apporter des contributions à l’économie mondiale, à la géopolitique mondiale. Ça a commencé avec le G7, qui il y a exactement 50 ans s’est réuni pour la première fois au château de Rambouillet. C’est une initiative du président Giscard d’Estaing.
Alors, vous allez trouver que je suis vraiment très vieux : j’y étais. Le hasard a fait que j’étais à l’époque à l’Élysée, aux côtés du président Giscard d’Estaing. C’était 1976. Mais nous venons de fêter au château de Rambouillet les 50 ans du premier G6/G7.
Et puis, il y a eu la montée des autres. Il y a quelques mois, j’étais à Genève avec le ministre indien des Affaires étrangères, dans un débat devant une salle de 300 places.
J’ai demandé au ministre Jaishankar de l’Inde : « Pourquoi est-ce que vous avez créé les BRICS, où se retrouvent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud ? »
Il m’a répondu : « Parce que vous avez créé le G7. »
Je lui ai dit : « Oui, mais depuis, nous — c’est-à-dire de nouveau la France — avons créé le G20 au moment de la crise financière de 2007-2008. »
Il m’a répondu : « Oui, bien sûr, et nous sommes heureux d’être au G20. Mais le G7 existe toujours. Donc nous, on a créé les BRICS. »
On voit qu’il existe, en dehors des Nations unies et des organisations internationales, des formats plus limités, informels, où se retrouvent — comme on dit en anglais — des like-minded, des pays qui partagent les mêmes ambitions, les mêmes aspirations.
Alors, ce ne sont plus les non-alignés. Ils s’appellent maintenant le Sud global.
Les BRICS, c’est le Sud global.
Et ils ne pratiquent pas le non-alignement, mais le multi-alignement. Si vous prenez par exemple l’Arabie saoudite : L’Arabie saoudite négocie le prix du pétrole avec la Russie, parce que ce sont deux pays producteurs très importants qui font partie de l’OPEP+. Ils vendent leur pétrole à la Chine essentiellement. Mais ils achètent leurs armements aux États-Unis. Et ça ne leur pose aucun problème.
C’est ça le multi-alignement. C’est la doctrine, la vision, que partagent les BRICS et, au-delà, tous les pays du Sud global.
Bonjour, je suis Inès, étudiante en deuxième année de licence LLCER chinois à l’Inalco, et je suis très heureuse d’être face à vous aujourd’hui.
J’aurais deux questions à vous poser.
La première : quel est aujourd’hui l’intérêt porté dans le secteur de la diplomatie aux profils formés en langue chinoise et spécialisés en Asie de l’Est ?
La seconde, plus personnelle : avez-vous pu constater, au cours de votre carrière, une évolution de la demande pour ce genre de qualification ?
Je vais commencer par la deuxième question.
Quand j’ai commencé ma carrière, c’était l’époque de Mao Zedong : la Révolution culturelle, le Grand Bond en avant. Bref : une catastrophe pour toute la Chine. La Chine était refermée sur elle-même, extraordinairement pauvre, avec des dizaines de millions de morts, de la famine. Et en plus, la confrontation entre l’URSS et la Chine, avec des dizaines de milliers de soldats soviétiques sur la frontière de l’Oussouri.
Inutile de vous dire que les hommes d’affaires ne se précipitaient pas à ce moment-là vers le marché chinois — qui n’existait pas. Il a fallu attendre les réformes de Deng Xiaoping, qui a succédé à Mao. À partir de 1979, il a lancé de façon très pragmatique, province après province, une série de réformes.
C’est vraiment lui le père de la transformation extraordinaire de la Chine.
D’autres pays se sont transformés au même rythme. Regardez la Corée, regardez Singapour. Mais, à l’échelle d’un pays comme la Chine, avec la population qui est celle de la Chine, il n’y a pas d’autre exemple. C’est à partir du moment — 1979 — où les réformes ont commencé à être mises en place que la Chine est devenue une puissance irrésistiblement attractive.
Elle a bénéficié, en plus, de deux transformations.
La première, c’est ce qu’on a tous dans nos poches : les téléphones portables. La Chine est devenue l’atelier du monde pour cette industrie, qui est devenue une industrie majeure. Mais pas seulement. L’industrialisation de la Chine porte sur bien d’autres domaines.
Et puis il y a eu une deuxième révolution, beaucoup moins connue, mais à mon avis tout aussi importante : celle des porte-conteneurs. Avant, il y avait des cargos, et il fallait beaucoup de temps et beaucoup de main-d’œuvre pour les charger et les décharger. Avec les porte-conteneurs, tout cela s’est accéléré.
Au moment même où la Chine émergeait de la catastrophe maoïste — du Grand Bond en avant et de la Révolution culturelle — au moment où Deng Xiaoping réussissait ses réformes économiques, la révolution des porte-conteneurs et la révolution des téléphones portables ont permis à la Chine de devenir l’atelier du monde.
S’agissant de l’apprentissage de la langue chinoise — mais aussi des autres langues, qu’il s’agisse du russe, de l’ouzbek, des langues africaines ou de l’arabe — si vous voulez être diplomate, ou si vous voulez vous installer pour y faire des affaires dans tel ou tel pays dit oriental (c’est-à-dire pas seulement l’Asie, mais vu par nos administrations aussi le Proche-Orient, l’Afrique), il est indispensable de connaître les langues et la culture des pays dans lesquels on va vivre.
Si vous êtes en Chine et que vous ne parlez pas chinois, vous êtes face à un milliard 400 millions de personnes — moins peut-être 200 ou 300 millions qui parlent l’anglais, un petit peu le français, pas beaucoup.
Vous êtes coupé de toute relation avec la population.
Et si votre métier vous amène à être en dialogue, en négociation, avec des interlocuteurs qui ne parlent que le chinois, l’arabe ou le haoussa, vous êtes muet face à votre interlocuteur.
Si vous avez passé quelques années à apprendre non seulement la langue, mais la culture, la civilisation, ça vous évite de faire des maladresses, des bêtises, sans vous en rendre compte.
Il y a des traits de civilisation, de culture, qui rendent tel ou tel mot sensible, telle ou telle expression à ne pas utiliser, etc.
Donc c’est indispensable, si vous voulez passer quelques années professionnelles dans un pays d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient, de pouvoir comprendre ce que votre interlocuteur dit, mais aussi, derrière les mots, ce qu’il attend de vous.
Et préparer une réponse adaptée grâce à votre connaissance de la culture.
Et comprise grâce à votre connaissance de la langue, par votre interlocuteur.
Et pour en revenir un petit peu à la Chine, récemment dans la presse, Louis Gallois, l’ancien PDG d’Airbus, recommande de reconnaître la supériorité technologique de Pékin et donc de conditionner l’accès du marché européen à des transferts de technologies et des coentreprises.
Qu’est-ce que vous en pensez ?
Je crois que ça joue dans les deux sens.
C’est-à-dire que, dans un premier temps, la Chine a voulu absorber tous nos produits, mais à une condition : qu’on donne tous les secrets de la fabrication de ces produits.
C’était au moment où la Chine décollait, et avait besoin non seulement d’importer, mais aussi d’obtenir des transferts de savoir-faire. C’était une condition qu’elle fixait pour tous les entrepreneurs qui souhaitaient bâtir des unités de production en Chine.
Puis la Chine a accompli ce développement extraordinaire. Et maintenant, dans un certain nombre de domaines très importants pour l’économie mondiale, ce sont eux qui ont cette avance technologique.
Et donc, après tout, ce n’est pas anormal de dire : Nous sommes un marché de 450 000 000 de consommateurs. Nous avons la puissance que nous donne cette masse économique fabuleuse. Donc, nous sommes en position de fixer nos conditions.
La Chine nous a fixé les siennes. Maintenant, c’est nous qui fixons les nôtres. Et puis après, on négocie. On essaie de trouver un terrain d’entente raisonnable.
Et donc, il nous faudra encore plus de diplomators et de négociators.
On a toujours besoin, y compris pour les chefs d’entreprise, de bons spécialistes de chacun des pays où ces entreprises sont présentes.
Quel que soit leur parcours — qu’ils soient issus d’un parcours diplomatique ou des meilleures écoles, HEC ou autres — il faut qu’ils aient d’abord une bonne connaissance et une bonne compréhension du pays dans lequel ils vont essayer de travailler, de négocier, de créer des entreprises, etc.
Et je crois que vous dites diplomators…
Non : on a besoin de bons diplomates.
Pas seulement pour faire de la diplomatie politique, mais aussi pour faire de la diplomatie économique.
Je ne peux que vous rejoindre. Et justement : est-ce que les entreprises et les institutions ont besoin d’une compréhension plus fine des enjeux géopolitiques ?
Et si oui, en quoi est-ce nouveau ?
Alors ça n’est pas nouveau, mais ça s’est aggravé.
D’abord parce que l’économie s’est globalisée. Maintenant, les chaînes de production partent de Chine ou d’Inde, et font littéralement le tour du monde, avec des éléments produits au Vietnam, au Maroc, etc. Donc, il y a d’abord le besoin de comprendre cette globalisation du fonctionnement de l’économie mondiale.
Deuxièmement, une fois qu’on a compris, il faut que les règles du jeu soient à la fois respectées et utilisées au mieux au service des entreprises. Et c’est aux entreprises de décider. Par exemple : est-il encore raisonnable de produire un produit très sophistiqué uniquement en Chine ? Ou est-il préférable de le produire en Chine, puis un peu au Vietnam, puis peut-être au Maroc ?
Et puis il y a des considérations de sécurité, parfois. On l’a vu au moment de la crise du Covid. On a découvert tout d’un coup que seule la Chine, ou l’Inde, ou les deux, produisaient les médicaments dont on avait absolument besoin. Et qu’elles étaient en état de nous dire : « Non, on en a besoin pour nous. Tant pis pour vous. »
Ça a été un moment de réveil assez brutal. On s’est dit : la globalisation a des limites. Il faut passer du global au “prudent”, en tenant compte des conditions de sécurité, à tous égards.
Merci beaucoup, Monsieur l’Ambassadeur.
Le mot de la fin pour nos étudiants : quels conseils donneriez-vous aujourd’hui à un étudiant de l’Inalco ?
D’abord, il a beaucoup de chance. Parce que l’Inalco est une pépite, un trésor français, avec des traditions et avec un savoir-faire exceptionnel. Être diplômé de Langues O’, ce n’est pas seulement l’apprentissage d’une, deux ou trois langues. C’est aussi l’apprentissage de l’histoire et de la civilisation de ces pays.
Vous ne pouvez réussir, si on vous envoie dans un pays dont vous parlez la langue, que si vous en connaissez aussi la culture, la civilisation. Cela vous permet d’agir, de parler, de séduire, de vendre ou de négocier dans des conditions favorables. C’est-à-dire en établissant un lien de compréhension à travers la langue, mais aussi un lien de sympathie.
C’est une dimension absolument fondamentale.
La relation humaine ne se limite pas seulement à la maîtrise de la langue. Que vous négociiez un traité diplomatique ou un contrat commercial, c’est une relation de personne à personne. Il faut que vous soyez capable de comprendre non seulement la langue employée, mais la culture qu’il y a derrière. Il y a des règles, il y a des gaffes qu’on peut faire sans même s’en rendre compte.
C’est cela que Langues O’ vous apprend : la langue, la culture, la civilisation des pays qui sont aujourd’hui absolument fondamentaux pour l’avenir de la France, l’avenir de l’Europe.
Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode.
N'hésitez pas à le noter et à le partager.
À bientôt pour un nouvel épisode de Multipolaire.
Pour plus d'infos, allez sur alumni.inalco.fr et adhérez à l'association des anciens élèves de l'Inalco.
Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Narastoria.

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés